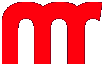
Analyse du catalogue de l’exposition “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître”1
Le choix n’est pas innocent. Mon intention d’analyser le catalogue de l’exposition “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître” qui se tient actuellement à La maison rouge fondation Antoine de Galbert, se base sur un intérêt personnel envers ce médium artistique qu’est la vidéo, mais également envers la représentation ou la transposition visuelle et analytique de celui-ci sur un support papier.
Si la question de “comment exposer l’art vidéo” a suscité un intérêt majeur depuis son apparition au début des années 60 au sein des différents organismes culturels et artistiques, elle soulève également une autre question moins visible mais non sans importance – comment présenter une exposition composée exclusivement d’œuvres audiovisuelles sur un support papier ? Contrairement aux autres médiums artistiques bidimentionnels et fixes comme la peinture, la gravure et la photographie, les oeuvres audiovisuelles nécessitent d’abord dans leur présentation publique des paramètres et des supports spécifiques appropriés, notamment une source de lumière, ou plus exactement d’émission artificielle via un téléviseur ou un projecteur et une salle noire, de préférence. Ces conditions, non seulement ne facilitent pas la tache de l’organisateur de l’exposition, mais elles imposent également des contraintes diverses à la fois aux différents intervenants professionnels et au grand public. Sans s’attarder trop longtemps sur les contraintes imposées aux grands publics, il n’est pas inintéressant d’en citer quelqu’unes. Parmi ces exigences, on peut citer le temps nécessaire à chaque visiteur pour appréhender une oeuvre audiovisuelle – et parfois, le temps nécessaire pour attendre simplement que l’œuvre en cours se termine pour la reprendre à son début –, le sens de l’orientation que nécessite le parcours dans les différentes salles obscures nécessairement étanches les unes par rapport aux autres, tant pour des raisons visuelles que sonores, et, ce qui me semble le plus important de tout, l’extrême concentration de visionnage que nécessite l’œuvre car, souvent, il est bien difficile de la revoir dans son intégralité en raison du temps de visite ou de la longue durée des œuvres. Au regard de ces inconvénients, le catalogue peut apparaître naturellement comme un recours bien utile permettant une lecture plus agréable et plus reposante pour revisiter les œuvres et l’exposition. Mais si cette solution peut effectivement s’appliquer dans la plupart des expositions constituées d’œuvres picturales ou plastiques, elle est bien plus difficile à appliquer à une exposition qui est entièrement constituée d’œuvres audiovisuelles comme c’est le cas pour l’exposition “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître”.
L’exposition est composée des vingt-cinq œuvres vidéographiques de la collection des Lemaîtres. Mise en forme par la conservatrice du Centre Pompidou Christine Van Assche, elle vise à présenter un panorama, choisi par elle, de la collection des Lemaîtres comprenant pour une large part des jeunes artistes émergents du monde entier. De Shanghai à Caire, de Porto Rico à Amsterdam, en passant par Lisbonne et Londres, les Lemaîtres semblent ne pas perdre leur temps dans leurs différents pèlerinages à travers le monde et ainsi, petit à petit, durant dix ans, ils ont construit une collection vidéographique à la fois riche de diversité et de sens. Suivant une logique de répartition selon la nature de chaque œuvre, la commissaire a réussit à classer cet ensemble vidéographique selon trois thèmes distincts : Poétique du monde, Politique de l’autre et Esthétique de l’échange, qui ont pour but d’éclaircir une approche théorique des œuvres et d’établir un fils conducteur dans une aventure de collectionneurs « amateurs » qu’ils avouent eux-même être très instinctive, faite de rencontres et de coups de cœur. Quant à la scénographie, discrète et très structurée à la fois, elle est minutieusement réalisée par le Bureau des mésarchitectures et semble parfaitement s’accorder à la spécificité de chaque pièce. La présentation des œuvres semble d’abord se fondre de manière très naturelle avec l’architecture particulière de la maison rouge et notamment avec ses espaces d’accueil et de restauration centraux. D’une grande convivialité en même temps que d’une grande contemporanéité, la maison rouge s’articule autour du petit pavillon réhabilité et peint de couleur écarlate donnant son nom et une identité très claire à la fondation ainsi qu’autour d’un patio intérieur très minéral invitant à la concentration. C’est autour de ce patio que quelques œuvres présentées sur des écrans plasmas accrochés au mur et éclairés par la lumière du jour invitent à pénétrer au sein d’entre-deux du parcours, non sans une certaine discrétion. La scénographie s’articule ensuite autour de différentes bulles dans lesquelles on pénètre en écartant des rideaux de plastique rouge rappelant l’identité de la fondation. Ces bulles hexagonales se regroupent en grappes comme autant d’essaims reliés par un parcours très fluide et des espaces intermédiaires dans lesquels s’inscrivent d’autres œuvres.
Quant au catalogue, d’un format broché B5, son contenu est divisé en trois parties. Une présentation de l’exposition avec photographies couleurs, plan axonométrique et index précède des textes en français dont un avant-propos d’Antoine de Galbert, le texte vidéo Chaosmos de Chantal Pontbriand, critique d’art et directrice de PARACHUTE, un entretien réalisé par le commissaire avec les collectionneurs et enfin éloge de l’amour de Mark Nash, producteur de films et professeur du département d’art contemporain au Royal College of Art de Londres. Enserrées entre des pages entièrement rouges qui rappellent la couleur dominante de la fondation, les soixante pages centrales sont consacrées à la présentation visuelle des œuvres repérées sur un plan, cette fois-ci zénithal en bidimentionnel accompagné d’une notice double page placée en vis-à-vis qui permet au lecteur de situer les relations spatiales entretenues entre les œuvres elles-mêmes. La dernière partie propose une traduction en langue anglaise des textes de la première partie. Si le texte de Chantal Pontbriand nous donne une vision philosophique et théorique sur la conception de l’exposition, notamment la notion de “collection” dans son sens à la fois muséographique et intime du terme, il soulève par ailleurs quelques problématiques à méditer concernant ce médium artistique dans sa relation avec les artistes et le monde. Quant à Mark Nash, en empruntant le titre du film de Jean-Luc Godard, éloge de l’amour, il traite, au travers de ses diverses expériences professionnelles passées, de la mise en forme et des difficultés particulières, à la fois techniques et téléologique, de l’exposition du médium audiovisuel. L’entretien avec les collectionneurs, quant à lui, éclaire particulièrement bien l’aventure personnelle et passionnante d’un collectionneur privé dans sa quête de la représentation de la complexité et de la beauté du monde mais aussi les questionnements et la démarche particulière d’un amateur situé en dehors du cercle dit professionnel. Les gestes de contemplation, d’acquisition, de “domestication”2 et de présentation privée ou publique prennent ici un sens très intime et très spontané d’où la spéculation et le calcul sont absents. Si la question du coût et des investissements se pose pour les collectionneurs c’est d’abord la pérennité des œuvres, technique et artistique qui est leur principal souci, après l’émotion et le coup de foudre esthétique. Leur parcours particulier prend dans cet entretien une dimension très pédagogique car, appréhendable par l’expérience, il opère comme une réduction de l’histoire somme toute assez neuve de ce média.
Sur la première de couverture du catalogue, une simple photographie d’une armoire de rangement, prise avec un axe central sépare, d’un côté un empilement de cassettes et de dvds divers et, de l’autre, une pille de vêtements rangés proprement. Au centre, s’inscrit la lettre “m” en minuscule – le logo de la fondation – habillé d’un chiffre 4 placé en indice qui signifie que c’est le quatrième volet du projet d’exposition autours du thème de la collection privée. La quatrième de couverture est réservée pour indiquer le titre de l’ouvrage avec une courte description du propos, les noms des artistes présentés et les auteurs de l’ouvrage avec un numéro d’ISBN, le prix en bas à gauche, le code barre et le logo des éditions Fage à droite, sur un fond rouge qui encore une fois rappelle la couleur symbolisant La maison rouge. Si cette image, me semble-t-il, fait partie des éléments les plus réussis dans la composition de l’ouvrage, c’est parce qu’elle illustre bien la dimension et la forme banales que prennent, dans ce cas précis, des œuvres audiovisuelles (de simples disques ou bandes qui n’ont aucun intérêt esthétique particulier), et que d’autre part elle dévoile la face cachée d’une collection privée dans sa conservation domestique et intime. Cette image, de part son contraste et sa banalité semble également poser le problème plus large du support. Si la vidéo, en raison de son rapport étroit avec une évolution technologique permanente, a suscité de nombreux questionnements liés à sa conservation, elle pose aussi la question de sa mise en forme sur des supports non audiovisuels. C’est sur cette question que nous allons revenir dans la deuxième partie de l’analyse de ce catalogue.
L’utilisation et la juxtaposition de cinq différentes maquettes de mise en page pour illustrer ces vingt-cinq œuvres vidéographiques montrent bien les difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’ouvrage et les efforts de graphisme nécessaires pour les surmonter. Une image unique en pleine page, trois plans successifs qui varient les points de vue, trois plans successifs mais cette fois au format 16/9 qui illustrent une succession de passage avec un accent mis sur la nature panoramique de l’image, douze plans de plus petite dimension qui suggèrent cette fois une narration dynamique de lecture, et enfin des images doubles séparées par un espace intermédiaire mais toujours présentées sur une seule page. Toutes ces variations et ces compositions tentent d’adapter et d’extraire les images en mouvement afin de donner une vision globale de chaque œuvre. Le résultat est assez limité comme nous pouvons l’imaginer, mais l’entreprise est difficile. L’essence d’une œuvre audiovisuelle tient non seulement au mouvement des images et à la variation des sons afin de créer une narration interne et autonome dans son rapport avec le regardeur, mais elle est aussi un travail sur le temps, sur la durée exigée par la contemplation d’une œuvre comportant un début et une fin. De ce point de vue, il semble évident que le support papier ne pourra jamais parfaitement illustrer ce type d’œuvre, qu’elle soit vidéographique ou filmique. Néanmoins, dans cette tentative quasi impossible, quelques pistes montrent, non qu’il est possible de restituer une œuvre dans son intégrité mais qu’une autre forme de support et d’expression peut donner des indications précieuses sur elle. Il faut ne pas chercher à imiter l’œuvre ou à la concurrencer mais bien plutôt à l’éclairer d’un regard neuf et biaisé. Les successions de plans, la répétition apparaissent comme un outil assez évident. Cette succession est d’ailleurs à l’origine de l’image en mouvement. Et cette méthode de présentation est d’autant plus efficace que l’œuvre en question est plutôt courte, presque abstraite et quasi muette. C’est le cas pour I Only Wish That I Could Weep de The Atlas Group/Walid Raad, Junks de Jeroen de Rijke & Willem de Rooij, One Minute to act a Title: Kim Jong II Favorite Movies de Mario Garcia Torres, Barbed Hula de Sigalit Landau et Threshold to the Kingdom de Mark Wallinger. Le son, en revanche est par nature exclu de cette transcription sur papier. Les œuvres dites longues et narratives qui jouent notamment sur une variation musicale ou sonore importante perdent toute leur qualité artistique et plastique en devenant une simple illustration au rôle plutôt documentaire. Pourtant, d’autres tentatives de transcription des images en mouvements ont été menées, à la limite du travail critique et de l’œuvre artistique. Nous pensons notamment au travail de Jean-Luc Godard, pris en référence dans ce catalogue, particulièrement à la version papier de son histoires(s) du cinéma. Ses superpositions d’images et de textes, de plusieurs images et la succession de celles-ci ont peut-être été les tentatives les plus abouties pour rendre le dynamisme et le mouvement d’œuvres cinématographiques. C’est peut-être que cette transcription était plus mentale et poétique que pratique et matérielle et que les évocations en deviennent elle-même dynamique et créatrices.
On peut également s’interroger sur l’avenir des catalogues d’œuvres vidéographiques. Particulièrement à l’heure d’Internet où l’accès direct aux œuvres, aux œuvres en mouvements est de plus en plus facile. Ce type de catalogue est sans doute appelé à évoluer et notamment à intégrer sur support dvd des extraits d’œuvres seuls capables d’en donner une idée précise. Cette question, relativement facile à mettre en œuvre (beaucoup de catalogues ou de livres intègrent déjà des dvds) pose évidemment celle du droit d’auteur d’une manière nouvelle.
L’autre question que nous voulons soulever ici concernant cette exposition et son catalogue porte sur l’enchaînement de l’ensemble des œuvres par rapport à leur regroupement selon trois thèmes d’exposition. Si l’ensemble de l’exposition nous livre intrinsèquement une vision du monde, celle d’un collectionneur dans sa recherche de la beauté au gré de ses rencontres artistiques, elle pose également la question du positionnement politique de l’artiste au travers d’expérimentations artistiques ou sociales. Néanmoins, la classification de la commissaire semble absente dans la présentation des œuvres. Réparties dans les trois salles d’exposition principales de La maison rouge, on pourrait croire que ces trois espaces visent à regrouper les œuvres selon les trois thèmes proposés par la commissaire. Il est pourtant surprenant que le parcours sensé être effectué par le visiteur ne suit ni ces trois classifications théoriques ni à une volonté esthétique apparente. D’une part, dans la répartition de l’espace d’exposition, on ne trouve nulle part l’indication de ces trois thèmes qui sont sensés relier certaines œuvres entre elles, et d’autre part on ne retrouve pas trace de cette classification en lisant les divers documents qui concerne l’exposition, du dossier de presse au livret explicatif fourni pour l’exposition. Il est surprenant de constater que la mise en oeuvre de l’exposition, comme celle du catalogue, à aucun moment, ne révèle ces trois thèmes qui pourtant caractérisent formellement la logique du commissariat. D’ailleurs, sur le plan de l’exposition, on peut même trouver une division de l’espace en quatre parties d’exposition qui ne correspondent évidemment pas à la conception du commissariat. On retrouve la même incompréhension dans la présentation de catalogue. La mise en page du catalogue elle-même se résume finalement à une page d’index où les œuvres pourtant numérotées ne répondent pas à la logique successive de l’exposition. On peut ici supposer que ces trois thèmes ont pour but de présenter une vision possible d’œuvres assez hétérogènes et que cette classification plutôt critique fait secrètement écho à une pratique assez instinctive et donc moins construite en terme esthétique ou historique de ces deux collectionneurs.
Comment exposer l’art vidéo et comment présenter l’œuvre audiovisuelle sur un support papier ? Ces questionnements me semblent liés l’un à l’autre. A travers l’exposition “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître”, nous avons vu la difficulté de présenter ce type de création artistique aussi bien dans l’espace de l’exposition elle-même que sur un support bidimentionnel. Certaines questions soulevées ici concernant ce catalogue peuvent paraître secondaire mais elle me semblent révélatrices des difficultés intrinsèques de ce support. Par ailleurs, l’achat d’un catalogue d’exposition peut éventuellement être considéré comme un acte de collection, une collection mise en abîme par la mémoire de l’exposition elle-même et le souvenir que nous en gardons. L’impossibilité faite au support papier d’une exposition consacrée à l’art vidéo de préserver une vision globale de l’œuvre audiovisuelle fait peut-être écho à la difficulté de conserver cette passion pour un collectionneur. Il est intéressant de terminer cette analyse sur cette phrase de Walter Benjamin citée par Mark Nash au début de sa contribution au catalogue : “Toute passion, certes, confine au chaos, la passion du collectionneur, en ce qui la regarde, confine au chaos des souvenirs.”3 Et en effet, ces images fragmentaires, ces sensations et impressions de l’œuvre que tente de fixer un catalogue ont affaire avec la mémoire. Elles sont une tentative de raviver l’émotion esthétique ressentie lors du contact direct avec les œuvres. Moins que tout autre, le catalogue d’une exposition d’œuvres vidéographiques ne remplace l’expérience directe de celle-ci et dans le même temps, à cette condition près de l’expérience directe, il permet une grande liberté de part la plasticité des œuvres. Il permet par de multiples effets de maquettes, de taille des images, de répétitions ou de flous exprimant le mouvement, de réévoquer l’œuvre plus diversement que ne le fait un catalogue de peinture qui offre une reproduction plus fidèle des œuvres sans en pouvoir évoquer les impressions plus diffuses qu’elles ont faites sur nous, les “souvenirs de l’œuvre”.
Notices:
1. “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître”, Coédition Fage et La maison rouge, Paris, 2006.
2. Chantal Pontbriand, “vidéo Chaosmos”, le catalogue de l’exposition “Une vision du monde, la collection vidéo d’Isabelle et Jean-Conrad Lemaître”, Coédition Fage et La maison rouge, Paris, 2006, p. 15.
3. Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothéque, trad. Philippe Ivernel, Payot & Rivages, Paris, 2000, p, 42.

